Caen dans la fournaise
Le souffle de la liberté
frôle Caen dès l'après-midi du 6 juin. Mais les alliés sont stoppés aux portes
de la ville. Or, le général
Montgomery
 , commandant en chef des armées
terrestres, avait annoncé : « Si l'ennemi nous devance à Caen et que ses
défenses se révèlent trop solides pour que nous puissions capturer cette ville
le jour J, Caen sera pilonnée par nos bombardiers afin d'en restreindre
l'utilité par l'ennemi. »
, commandant en chef des armées
terrestres, avait annoncé : « Si l'ennemi nous devance à Caen et que ses
défenses se révèlent trop solides pour que nous puissions capturer cette ville
le jour J, Caen sera pilonnée par nos bombardiers afin d'en restreindre
l'utilité par l'ennemi. »
C'est ce qu'il advient. Jour
après jour, nuit après nuit, la
Royal Air Force
 prend la cité normande pour
cible. Le cauchemar des Caennais qui, par milliers, survivent ou meurent dans la
fournaise, durera jusqu'au 19 juillet.
prend la cité normande pour
cible. Le cauchemar des Caennais qui, par milliers, survivent ou meurent dans la
fournaise, durera jusqu'au 19 juillet.

Localisation des rues et places citées
Plus que quatre jours. A Caen, dans
sa petite chambre de la
rue des Carmes,
Gilles Rivière, vingt ans, révise son
programme avec hantise du compte à rebours. Étudiant en troisième année de dro
it,
il passe son examen le 9
juin. Dans quatre jours. A minuit, il ferme ses bouquins. Son copain fait de
même, et regagne sa piaule située dans le même immeuble : le vénérable et
prestigieux hôtel de l'Intendance.


Source: Collection privée, page 167 de ce
livre.
L'hôtel de l'Intendance, 44 rue des Carmes.
Un peu vanné, Gilles Rivière s'endort
aussitôt. Demain, il faudra remettre ça.
Un peu plus au nord de la ville,
place Saint-Martin, Jean Rolland, un lycéen de seize ans, fait ses devoirs en
famille. Son père, avoué, compulse ses registres. Sa mère raccommode. Et son
frère peine sur un problème de maths. Sous le grand lustre de la
salle
à manger, la
soirée est paisible.
De l'autre côté du château, rue des Cordes,
Bernard Goupil, trente-trois ans, dort du sommeil du juste. La journée a été
harassante. Agent général d'assurances, Bernard Goupil a une grosse clientèle
dans la campagne environnante et parcourt des dizaines et des dizaines de
kilomètres à bicyclette. Aujourd'hui, sa tournée l'a conduit du côté d'Argences,
à l'est de Caen. Les temps sont durs.
« J'espère que les Anglais vont
bientôt arriver, lui a lancé
un
client plein d'espoir.
- Faut pas rêver, a répondu l'agent
d'assurances, le débarquement n'est pas pour demain. »
Au théâtre municipal de Caen,
Véronique, la
pimpante opérette d'André
Messager, fait un tabac. Comme d'habitude, de nombreux soldats allemands sont
dans la salle, mais après le premier entracte, aucun d'entre eux ne revient
s'asseoir dans les fauteuils. A commencer par l'Oberleutnant Rater qui avait
pris place dans la loge réservée à la
Kommandantur. Cette absence subite
d'uniformes ne gêne évidemment personne, et rien ne vient troubler la suite de
la représentation. L'administrateur du théâtre se frotte les mains. Demain soir
6 juin, pour la dernière, la salle sera encore comble.
A la sortie du spectacle,
Chantal Nobécourt (Note de MLQ:
dirigeante des équipes féminines des
Equipes
d'Urgence
 ) discute avec son frère Jacques. Parvenue sur la place
Saint-Martin, elle remarque le ciel changeant, rougeoyant.
) discute avec son frère Jacques. Parvenue sur la place
Saint-Martin, elle remarque le ciel changeant, rougeoyant.
"La
lune est bizarre ce soir, dit-elle à son frère, il va se passer quelque chose."
Quelques minutes plus tard, des grondements
sourds et réguliers se font entendre dans le lointain.
"Si
vraiment il se passe quelque chose, il faut aller chercher du pain."
Jacques Nobécourt est interloqué :
« Du pain ! A minuit?
- Oui, je connais un boulanger. Il doit être en
train de travailler. C'est sur notre chemin. »
Gilles Rivière se réveille en
sursaut. Il est un peu plus de 7 heures du matin, et son copain de la veille
vient de débouler bruyamment dans sa chambre :
"Tu as dormi, toi ?
- Bah oui...
- T'as rien entendu ? "
Le copain contemple Gilles d'un
air effaré. Lui-même n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Trop de boucan. Des avions, mais aussi un grondement sourd du côté de la côte : des bombes, peut-être même des canons.
« Ça a recommencé tout à l'heure.
Mais plus près.
»
Les deux amis sortent, cherchent
à se renseigner. Mais le
quartier Saint-Jean, cœur de la cité, présente son
aspect ordinaire. Les gens sont calmes, commencent à s'aligner en longues files
d'attente devant les boutiques. Sur le pavé, aujourd'hui comme hier, c'est le
dernier salon où l'on cause. Les deux étudiants recueillent quelques évasifs
tuyaux, quelques impressions invérifiables assenées comme des certitudes. Les
habituelles rumeurs de la ville, les bobards.
Un peu avant midi, Gilles
Rivière traverse la rue des Carmes, pénètre dans un immeuble qui fait face à
l'hôtel de l'Intendance. C'est ici, chez une vieille dame, qu'il prend son
déjeuner quotidien.
La vieille dame aussi affirme
qu' « il se passe quelque chose ». Gilles veut bien la croire, mais quoi? La
chambre réquisitionnée par l'officier allemand est vide et il possède un poste
de TSF. Il suffit de tourner le bouton : c'est ainsi que le jeune homme prend
connaissance d'un débarquement allié sur les côtes normandes.
9 H 17 : Le communiqué n°1
est publié : " URGENT, URGENT. Juin 6, 1944, communiqué n°1 du SHAEF : Sous le
commandement du général EISENHOWER, des forces navales alliées, appuyées par de
puissantes forces aériennes, ont commencé le débarquement des armées alliées ce
matin sur la côte du nord de la France".
L'esprit occupé par la grande
nouvelle, la tête pleine de questions, il passe à table, avale vite fait son
repas. A 13 h 30, Gilles Rivière en est au fromage. Il le laissera dans
l'assiette.
L'horreur. Acte I. Un bruit
énorme, terrifiant recouvre la ville. Puis c'est la grande secousse. Un déluge
de bombes écrase le quartier Saint-Jean, le quartier Saint-Julien, les abords du
château. Premiers incendies, premiers morts, premier désastre.
L'alerte passée, Gilles Rivière s'élance
au-dehors. Il enfourche son vélo, fonce à travers les ruines. Il ne va pas loin.
Cinquante mètres plus loin, ses deux pneus sont crevés. Il continue à pied,
court dans les gravats. Responsable de
l'Equipe d'urgence des étudiants des
facultés, Gilles Rivière n'a qu'une idée en tête :
rejoindre au plus vite son lieu de
rendez-vous prévu en cas de coup dur le lycée Malherbe.

Le lycée Malherbe, à droite Saint
Etienne.
A la même heure, Jean Rolland est déjà à pied d'œuvre. A
seize ans, c'est l'un des plus jeunes, sinon le plus jeune membre de la
Défense
passive (DP) de Caen. « C'était autant pour me protéger que pour me rendre utile »,
dit-il modestement aujourd'hui. Car les Allemands surveillaient de très près
l'identité des jeunes pour le
Service du travail obligatoire. Ils procédaient à
des vérifications à la sortie des établissements scolaires, notamment au lycée
Malherbe où Jean était élève. S'enrôler dans les rangs de la Défense passive
diminuait les chances d'être réquisitionné, le rôle de la DP étant relativement
respecté par l'occupant.
De plus, l'exemple vient d'en haut pour Jean Rolland :
son père est
chef du poste sanitaire n° 2. Et au moment de son affectation comme
agent de liaison, le discours du paternel a été très clair : « Si tu es de
service lors d'une alerte, tu viens. Si c'est en période de composition
scolaire, tu continues à travailler. S'il y a des bombardements, service ou pas
service, composition ou pas composition, tu viens. »
En ce mardi 6 juin, Jean Rolland est donc arrivé très tôt
dans le local de la place Blot, situé au nord de Caen, près du
jardin des
Plantes. Le vacarme de la nuit, la canonnade sur la côte ont d'ailleurs mis tout
le personnel en alerte. Sans aucun ordre, la quarantaine de brancardiers, les
médecins et les infirmières ont rallié le poste sanitaire n° 2, et lorsque
survient le bombardement de 13 h 30, ils sont immédiatement opérationnels.
Par bonheur, les bombes qui dévastent le quartier
Saint-Julien et les abords du château épargnent le poste sanitaire n° 2. Les
agents de la Défense passive partent en mission. Organisés par îlots, ils
repèrent les immeubles effondrés, tentent de dégager les malheureux enfouis sous
les décombres, coincés sous des tonnes de gravats. Les blessés affluent place
Blot. On n'y garde que les plus légèrement touchés. Les autres sont
immédiatement transportés à l'hôpital du Bon Sauveur. Course contre la montre,
course contre la mort.
Le jeune Rolland est surpris de se sentir si calme, si résolu. Une chose
l'impressionne : le formidable dégagement de fumée et de poussière provoqué par
les explosions et l'effondrement des bâtiments. « L'odeur de poussière surtout,
une poussière suffocante qui vous prenait aux poumons et vous asphyxiait. »
Premier choc. Premières séquences atroces.
Place des Petites-Boucheries, un agent de la DP, coiffeur de
profession, trouve sa propre maison complètement rasée. Mais sa femme gît sous
les ruines. Elle est vivante, on l'entend. Le coiffeur dirige lui-même les
recherches, oriente les sauveteurs qui déblaient avec frénésie. Peu à peu sa
voix faiblit, puis s'éteint. On l'arrache enfin à son carcan d'éboulis. Elle est
morte.
Le vieux notaire, lui, est bien vivant. On a pu le dégager à
temps. Hébété, choqué, il semble ailleurs, dans un monde de calme et de
plénitude, loin de tout ce bruit et cette fureur. Il demande à voir M. Rolland,
l'avoué qu'il connaît bien : « Veuillez m'appeler un taxi, demande-t-il avec
dignité, sinon ma femme va finir par s'inquiéter de mon retard. »
Rolland envoie son fils à
la direction de la
Défense passive
à l'hôtel de ville, pour rendre compte de la situation, pour prévenir
également que le poste sanitaire n° 2 est intact. Jean enfourche sa bicyclette
mais, parvenu à la place de la Mare,
bute sur un océan d'obstacles.

La Place de la
Mare au bas du Gaillon
Il prend son vélo sur l'épaule, entreprend un parcours
de vélocross, escalade les collines de gravats, traverse des barricades de
pierres, dégringole dans les trous béants. Jusqu'à la mairie,
place de la République.
Là, c'est plus dur encore. Un univers de cris, de larmes, de
souffrances. Les salles se remplissent d'hommes, de femmes et d'enfants blessés,
parfois atrocement mutilés. Toutes les énergies sont réquisitionnées. Jean doit
donner un coup de main pour les soins. Il est dans la salle des pansements,
s'oblige à regarder, à ne pas se détourner.
« Je me souviens m'être dit :" Tu dois faire face, ce n'est
qu'un début... »
Quelques jours plus tard, alors qu'il brancardait un blessé
dans les couloirs du lycée Malherbe, Jean Rolland fut « soufflé » par
l'explosion d'une bombe. Fortement commotionné, il devait souffrir de bégaiement
durant de longues années.
Retour place Blot. Les secouristes continuent de se battre,
creusent à coups de pelle et de pioche, déblaient à mains nues.
Il y a encore des vies en péril, des
blessés qui agonisent. A 16 h 30, le ciel s'emplit à nouveau d'un terrible bruit
d'avions.
L'horreur. Acte II. Cette fois,
le cœur de la ville est touché de plein fouet. Tout tremble, tout vacille, tout
s'écroule. Épargnés par le premier raid, des pâtés de maisons tombent en
poussière, ensevelissant dans leur chute des dizaines et des dizaines de
personnes. Des bombes s'éparpillent sur la ville. Un pavillon du Bon-Sauveur
s'écroule sur les malades : pour signaler aux avions la présence de cet hôpital,
on se hâte de fabriquer une gigantesque Croix-Rouge avec le champ opératoire des
blessés : compresses, pansements maculés de sang.
Au
poste sanitaire n°1,
aménagé dans le vieux et monumental pensionnat Saint-Jean 29 rue des Carmes, on compte les morts
que les secouristes amènent sur des civières ou sur des brancards de fortune,
des persiennes, des portes...
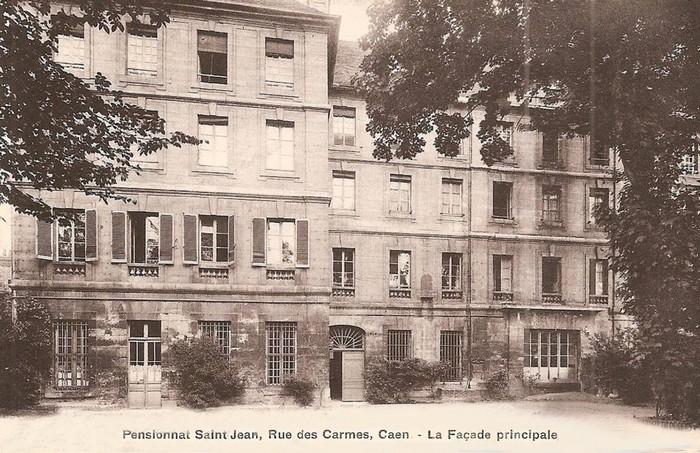

C'est Bernard Goupil, l'un des
deux chefs-adjoints du poste qui est chargé de les identifier. Sous ses yeux,
défilent les victimes : il faut fouiller les cadavres, chercher leurs papiers,
inscrire les noms, remplir les fiches. Certaines d'entre elles restent en blanc.
On ne sait rien de ces malheureux, on ne saura jamais rien.
Bernard Goupil reconnaît une
famille entière : les parents, les enfants... La famille d'un entrepreneur de
maçonnerie qui avait bétonné son abri pour le rendre plus solide. Deux obus sont
tombés en même temps de chaque côté de la tranchée, écrasant les occupants entre
deux parois de béton.
Le ciel est à nouveau serein,
mais Caen se débat dans les flammes de l'enfer. Malgré les efforts désespérés
des pompiers et des secouristes, les incendies se propagent, prennent des
proportions considérables. On doit faire évacuer la clinique des Oblates (ou
clinique Saint Joseph au N°11 rue de l'Engannerie), trop
exposée, et quatre-vingts blessés se retrouvent au poste sanitaire n°1. Pas
pour longtemps. Bientôt, le vent pousse le feu vers le pensionnat Saint-Jean.
Les blessés sont à nouveau déplacés, transportés dans le dispensaire de la
Miséricorde, transformé en hôpital complémentaire.
La nuit tombe sur un hallucinant brasier.
Quelques avions sillonnent à nouveau le ciel de Caen. De nombreuses fusées
parachutes se balancent dans l'air. Elles encadrent le quartier Saint-Jean,
illuminent les ruines comme pour un sinistre son et
lumière. Quelques minutes plus tard, un
millier de
Lancaster  et de
Halifax
et de
Halifax 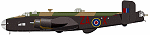 survolent la cité martyre. Il est 2 h 40 du
matin.
survolent la cité martyre. Il est 2 h 40 du
matin.
L'horreur. Acte III. Le cœur de la ville explose, s'émiette,
se pulvérise. Entre
la Prairie et le port, la rue d'Auge et le boulevard, Caen
est haché par les bombes.
Tragédie parmi les tragédies, le dispensaire de la
Miséricorde, qui quelques heures plus tôt avait accueilli les blessés du poste
sanitaire, s'effondre. On ne pourra dégager qu'une douzaine de rescapés. Près de la Prairie, la caserne des pompiers est rasée. Dix sept hommes sont tués, tout
le matériel est anéanti.

"Collection particulière, avec l'aimable
autorisation de François Robinard" La caserne des pompiers.
Le quartier Saint-Louis est dévasté, l'église Saint
Jean s'embrase. Les abris de la place de la République s'affaissent, se
referment en un piège mortel sur ceux qui s'y étaient réfugiés. Rue de Geôle,
les bombes engloutissent l'imprimerie du Journal de Normandie. La
rotative est en miettes. Personne ne lira le numéro du 7 juin, avec à la une
l'édito de son directeur qui titrait : « Et si c'était le débarquement
? »
Recueilli auprès d'André Gosset, alors ouvrier du Livre à
l'imprimerie du journal.
Dans ce chaos dantesque,
l'ancien pensionnat Saint-Jean
de la
rue des Carmes a tenu le choc. Mais les secouristes sont réduits à
l'impuissance, prisonniers d'une jungle de débris infranchissables, cernés par
des montagnes de décombres. Toute action est devenue impossible. Ordre est donné
de se replier sur le
poste n° 2 de la place Blot.

"Archives
départementales du Calvados". La rue des
Carmes, dans le fond l'église Saint Jean.
Comme tous ses copains des Equipes d'Urgence, Gilles Rivière
a fouillé, creusé, déblayé, transporté, sauvé... Avant de s'écrouler, de prendre
quelques heures de repos au « quartier général »: les douches du lycée Malherbe.
« C'est là que nous nous reposions. Parmi les pics, les
pelles, et les pioches, si serrés les uns contre les autres que nous ne pouvions
tous nous étendre que d'un seul côté. Avec interdiction de bouger. Le premier
qui se retournait obligeait les autres à faire de même. »
Vers 4 heures du matin, Gilles voit surgir son camarade de
l'hôtel de l'Intendance. Le visage couvert de traces de plâtre.
"C'est tombé sur la baraque, annonce-t-il sobrement, elle est en train de
brûler"

Source: page 84 de ce
livre;
l'Hôtel de l'Intendance
Il raconte aussi que tous ceux qui sont descendus à la cave
sont indemnes. Mais le couple de propriétaires et les quatre employés restés
dans la cuisine sont morts.
Gilles Rivière décide de se rendre sur place. Plus facile à
dire qu'à faire. Une fois parvenu aux abords du quartier Saint-Jean, il se rend
compte avec effarement qu'il ne retrouve plus son chemin. Ce parcours qu'il
connaît par cœur, qu'il accomplit quotidiennement depuis trois ans n'existe
plus. Il n'y a plus de rues, plus de places, plus de carrefours, plus rien. Pour
se repérer, il doit faire le tour jusqu'aux rives de l'Orne, puis revenir en
longeant le canal.
Quand il arrive enfin rue des Carmes, l'hôtel de l'Intendance
est la proie des flammes. Seules quelques chambres sont encore épargnées par le
feu, dont la sienne. Il rentre dans l'immeuble, réapparaît quelques secondes
plus tard : il a sauvé un pantalon et ses cours de droit. Il veut y retourner.
On le retient. Il était temps. La toiture s'écroule.
L'horreur. Acte IV. L'ordre, croit-on, est venu de la
Kommandantur de Rouen. Avant que Caen ne succombe sous les coups de boutoir des
alliés - ils sont déjà aux portes de la ville - il faut supprimer «
les
terroristes » emprisonnés à la Maladrerie. Aucune autre explication plausible ne
peut être fournie pour l'acte monstrueux qui va suivre. Il n'y a dans la ville
aucun signe de soulèvement depuis l'annonce du débarquement. Pas le moindre
sabotage, pas le moindre attentat qui auraient pu entraîner de sanglantes
représailles. A la prison elle-même, les détenus ne tentent aucune mutinerie.
Pas même le plus petit chahut. Aucune provocation. Tout est calme.
Vers 10 h 30, ce sont les premières exécutions.
Extrait de sa cellule située au troisième étage,
Marcel Barjaud
 (témoignage recueilli en 1984) , résistant du
réseau Arc-en-Ciel,
arrêté le 23 mai 1944 sur dénonciation dans son imprimerie de la rue de la
Monnaie, se retrouve dans le couloir, en tête d'un groupe de six hommes.
D'autres groupes, toujours de six hommes, se forment également. Un officier
allemand commande les déplacements, note les passages. Apparemment, quelque
chose ne colle pas. Cafouillage, bousculade. Poussé dans le dos par un soldat,
Marcel Barjaud se retrouve propulsé dans un autre groupe. En queue du peloton de
la demi-douzaine de prisonniers qui se dirige vers les courettes de promenade.
(témoignage recueilli en 1984) , résistant du
réseau Arc-en-Ciel,
arrêté le 23 mai 1944 sur dénonciation dans son imprimerie de la rue de la
Monnaie, se retrouve dans le couloir, en tête d'un groupe de six hommes.
D'autres groupes, toujours de six hommes, se forment également. Un officier
allemand commande les déplacements, note les passages. Apparemment, quelque
chose ne colle pas. Cafouillage, bousculade. Poussé dans le dos par un soldat,
Marcel Barjaud se retrouve propulsé dans un autre groupe. En queue du peloton de
la demi-douzaine de prisonniers qui se dirige vers les courettes de promenade.
Nouvel arrêt à l'entrée des courettes. Un
autre officier intervient, un cahier d'écolier à la main. Sur ce cahier, une
liste. Il demande son nom à Barjaud, ne le trouve pas, fait sortir le prisonnier
du rang et lui ordonne de se plaquer la face contre le mur, bras en l'air.
Collard (
Note de MLQ: Jacques
Collard arrêté avec son père
Arthur Collard
 le 22 mai 1944)
, un gamin de quinze ans, se retrouve dans la même position. Pendant ce
temps-là, leurs compagnons franchissent la porte qui ouvre sur les courettes. En
tournant légèrement la tête sur le côté, Barjaud les aperçoit. C'est à chaque
fois le même sinistre cérémonial : un groupe, la porte qui se ferme, une
mitraillette qui tire au coup par coup. Une balle dans la nuque. Et parfois, un
coup de grâce. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite.
le 22 mai 1944)
, un gamin de quinze ans, se retrouve dans la même position. Pendant ce
temps-là, leurs compagnons franchissent la porte qui ouvre sur les courettes. En
tournant légèrement la tête sur le côté, Barjaud les aperçoit. C'est à chaque
fois le même sinistre cérémonial : un groupe, la porte qui se ferme, une
mitraillette qui tire au coup par coup. Une balle dans la nuque. Et parfois, un
coup de grâce. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite.
Barjaud attend son tour. A trois reprises, l'officier revient
vers lui, l'interroge sur son nom, et à chaque fois le traite de menteur. Or, le
Français ne ment pas. Il sait qu'il va être exécuté et il veut que sa famille
puisse le retrouver et récupérer son corps.
Mais l'officier s'entête, ne décolère pas. Sur son cahier,
est inscrit le nom de Mariaud. Il n'a pas de Barjaud. Un R et un I qui sauvent
le Caennais. Avec Collard, qui lui non plus ne figure pas sur la liste, il se
retrouve projeté sur sa paillasse, souffrant simplement d'un coup de pied au
cul.
André Lebrun
 (témoignage recueilli en 1984) - également
membre du réseau Arc-en-Ciel, arrêté le 28 mai 1944 - voit la porte de sa
cellule s'ouvrir brusquement : « Jouvin, Loslier... Raus ! »
(témoignage recueilli en 1984) - également
membre du réseau Arc-en-Ciel, arrêté le 28 mai 1944 - voit la porte de sa
cellule s'ouvrir brusquement : « Jouvin, Loslier... Raus ! »
Le 7 juin 1944, une colonne d'une vingtaine de
prisonniers dont Arthur et Jacques Collard ainsi qu’André Lebrun, s’ébranle de
la maison d'arrêt de Caen sous la surveillance d'une quarantaine d'Allemands, en
direction de Fresnes, dans la région parisienne. Ces hommes ont échappé au
massacre du 6 juin. La colonne traverse Caen et se dirige vers
Falaise puis
Argentan. Les prisonniers sont requis à Argentan pour déblayer les ruines.
Puis la pénible marche reprend et ils arrivent à
Fresnes
le 23 juin. Les hommes sont entassés dans de sinistres cachots et les
interrogatoires et les tortures recommencent, notamment pour les résistants
d'Arc -en-Ciel.
Les prisonniers vont connaître des fortunes très
diverses. Arthur Collard est conduit un matin de juillet 1994 au
Mont
Valérien où il est fusillé.
Pour André Lebrun et Jacques Collard, les tourments ne
sont pas terminés. Au début du mois d'août, ils avaient été transférés à la
prison Saint-Gilles de
Bruxelles.
La débâcle allemande entraîne leur chargement à la hâte dans des convois à
destination des mines de sel de Silésie. Mais le train est bombardé et doit
faire demi-tour vers Bruxelles où les détenus sont maintenus dans les wagons.
Les prisonniers décident de s’évader et se dispersent dans la ville. Ils sont
libérés quelques heures plus tard, le 3 septembre 1994, par l'entrée des Alliés
dans la ville.
Source:

On leur dit de laisser leurs affaires, ce qui n'est pas bon
signe. Lebrun reste seul. Il n'est pas du voyage. Monté sur les châlits, il se
contorsionne, parvient à glisser un regard à travers le vasistas. Depuis les
premiers coups de feu, il n'avait plus guère d'illusions, mais cette fois, c'est
une certitude : il aperçoit le corps du lieutenant Martin
 , baignant dans son
sang.
, baignant dans son
sang.
MARTIN,
Georges. Né le 16 avril 1905 à
Parcé
(Sarthe). Marié, deux enfants. Lieutenant de
Gendarmerie
à Redon, muté
dans le
Calvados en février 1944 pour commander la section de
Caen. Membre de
l'Armée
secrète puis des
FFI en
Bretagne (avec le grade de capitaine). Arrêté par la
Gestapo à la
caserne de gendarmerie de Caen le 28 mai 1944,

sur instructions venues de
Rennes.
Pourrait avoir quitté la maison d'arrêt de Caen au début du mois de juin 1944 et
n'aurait donc pas été fusillé en cet endroit. Disparu.
Source:
 et
et

Il y a aussi le docteur Derrien
 , abattu l'après-midi, et qui horriblement
torturé quelques jours plus tôt, avait confié à André Lebrun : « T'en fais pas,
on est dans le bon, c'est pour bientôt. » Il y a le comte Guy de Saint-Pol
, abattu l'après-midi, et qui horriblement
torturé quelques jours plus tôt, avait confié à André Lebrun : « T'en fais pas,
on est dans le bon, c'est pour bientôt. » Il y a le comte Guy de Saint-Pol
 ,
originaire d'Amayé-sur-Seulles, qui le matin encore servait la soupe aux
détenus. Abattu quelques heures plus tard. Il y a l'unijambiste inconnu qui
voulut mourir de face, tenta de saisir la mitraillette de son assassin. Fauché
par une rafale en pleine tête alors qu'il hurlait de toutes ses forces : «
Salaud, salaud ! »
,
originaire d'Amayé-sur-Seulles, qui le matin encore servait la soupe aux
détenus. Abattu quelques heures plus tard. Il y a l'unijambiste inconnu qui
voulut mourir de face, tenta de saisir la mitraillette de son assassin. Fauché
par une rafale en pleine tête alors qu'il hurlait de toutes ses forces : «
Salaud, salaud ! »
Autre version selon page 57 de

Toujours dissimulé derrière sa cloison, le surveillant
Jelot voit se poursuivre l'infernal manège avec un troisième et ultime groupe de
prisonniers. L'homme placé en dernière position avance péniblement. Il a une
jambe de bois*. Lorsque son tour arrive de pénétrer dans la courette, il est
pris d'un mouvement de recul à la vue des corps de ses camarades et glisse.
L'officier qui se tenait à ses côtés le saisit alors et lui tire une balle dans
la tête avant de l'envoyer rouler sur le sol au milieu des mares de sang.
*André ROBERT
 .
Né le 21 septembre 1915 à
Meuvaines
(Calvados). Célibataire. Cultivateur à
Longvillers.
Membre du réseau «
Alliance ». Arrêté à son domicile par la
Gestapo le 4 mai
1944.
.
Né le 21 septembre 1915 à
Meuvaines
(Calvados). Célibataire. Cultivateur à
Longvillers.
Membre du réseau «
Alliance ». Arrêté à son domicile par la
Gestapo le 4 mai
1944.
Il y a les autres. Les exécutions durent toute la journée du
6 juin et une bonne partie de la nuit. Les survivants tapent contre les murs de
leurs cellules pour faire les comptes. Le matin du 7 juin, quand on les embarque
pour Fresnes, ils continuent, tente de chiffrer le nombre des disparus :
quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-six, quatre-vingt-sept, plus encore... Ils ne
savent pas.
On ne saura jamais.
Cinquante ans après, on ignore toujours ce que les Allemands
ont fait des corps des fusillés de la prison de Caen. Il est généralement admis
qu'ils furent transportés dans la campagne environnante - l'hypothèse de la
forêt de Balleroy est souvent citée -pour y être enterrés.
7 juin. Le jour se lève sur une ville fantôme. Hébétés, les
habitants s'extraient peu à peu des caves et des abris, errent dans les ruines
comme des naufragés rejetés sur un rivage inconnu. Le désastre est trop soudain,
le malheur trop grand : il y a moins de vingt-quatre heures, on annonçait les
Anglais aux portes de la ville, on les avait aperçus au bout de la rue des
Tilleuls. La libération, si longtemps attendue, si longtemps désirée, était à
quelques centaines de mètres, à portée de main. Et puis le trou noir, le
cauchemar. Très vite, l'incompréhension colle au désespoir : pourquoi cet
acharnement à vouloir détruire Caen, à vouloir massacrer des vies innocentes et
amies? Il y a des centaines de morts, des centaines de blessés, des milliers de
sinistrés, dans une cité qui ne compte guère qu'une garnison de trois cents
soldats allemands. Pourquoi donc cette injustice ?
Ce bombardement intensif avait pour but d'empêcher le
passage des renforts allemands, notamment les blindés, en direction du front.
Stratégie dont l'utilité soulève aujourd'hui encore bien des controverses parmi
les Caennais. La capitale de la Basse-Normandie - surnommée « l'enclume de la
victoire » par un historien britannique - ne fut donc libérée que le 19 juillet.
L'artillerie allemande pilonna ensuite la ville jusqu'au 17 août.
Et si ça recommençait? Le feu qui dévore le centre attise la
peur. A tout moment, la mort peut jaillir du ciel. Et ça recommence, et ça va
recommencer jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine. Tandis qu'à
quelques kilomètres, les
cloches des églises tintent joyeusement en l'honneur de la liberté retrouvée,
que l'on danse sur l'air de la fraternité et de la reconnaissance, Caen
s'enfonce dans un long, très long crépuscule de souffrances : la population
émigre dans la campagne, se dirige en troupeaux vers les centres d'accueil ou se
terrent comme des troglodytes au fond
des grottes creusées dans les carrières de
pierre. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Le quotidien est
cassé, fracassé, laminé. Plus rien ne va de soi : ni manger, ni dormir, ni même
enterrer ses morts. Il n'y a plus qu'une seule routine : survivre.
C'est la grande fuite. Sinistrés
et paniqués, hantés par la perspective d'avoir à affronter de nouveaux
bombardements, poussés par les flammes comme des animaux par un feu de forêt,
les Caennais désertent la cité de l'indicible peur, s'écartent du périmètre de
la mort. Des milliers d'entre eux s'arrêtent au nord-ouest de la ville, trouvent
asile dans une sorte d'énorme forteresse de la sauvegarde, elle-même composée de
trois monuments de la vie urbaine, jumelés par les murs et l'histoire locale :
l'abbatiale Saint-Étienne, l'hospice du Bon-Sauveur et le
lycée Malherbe.

Le plan ci-dessous est orienté différemment

Ce qu'on a appelé le « grand
îlot sanitaire » de Caen naît ainsi, dans un déferlement de réfugiés qui
s'engouffrent sous les portails, se répandent sous les voûtes historiques,
s'éparpillent dans les travées, les couloirs, les salles, les classes et les
bureaux, échouent sur des paillasses, et quand il n'y a plus de matelas, sur de
la paille étalée à même le pavé. Comme dans une étable...
En l'espace de quelques heures,
cette enceinte à trois têtes se transforme en un gigantesque camp de nomades.
Arrachées à leurs maisons et à leurs habitudes, les familles reconstituent sur
quelques mètres carrés un chez-soi précaire et dérisoire. Dans un va-et-vient
continuel, elles ramènent valises, balluchons et quelques babioles sauvées de la
catastrophe. Elles s'agitent, s'activent, s'installent sous le regard vide de
vieillards prostrés, tandis que les gosses aux rires insouciants courent et
slaloment entre les paquets. Les bombes n'ont pas seulement rasé les maisons,
elles ont fait exploser les barrières sociales : riches et pauvres, nantis et
démunis, se côtoient, se mélangent, affrontent à égalité la même épreuve. Ne
demeure plus qu'un privilège, qu'un seul : celui d'être encore en vie.
Microcosme d'un monde chamboulé, fellinien
jusque dans ses odeurs, cet univers baroque traîne dans son sillage toutes les
extravagances, toutes les contradictions du genre humain : déchéance et dignité,
abattement et vitalité, courage et lâcheté, folie et lucidité.
Avec effarement, l'abbé
Lenormand, vicaire de l'église Saint-Étienne se rend compte que les centaines de
Caennais qui s'entassent sur les bas-côtés de l'édifice croient en la parole du
poète anglo-normand Robert Wace :
« Quand Saint-Étienne croulera,
monarchie anglaise disparaîtra... »
La rumeur s'est répandue comme
une traînée de poudre : de ces deux petites lignes, de cette légende médiévale,
les réfugiés de Saint-Etienne tirent une certitude stratégique : la Royal Air
Force ne peut mettre en péril l'existence de son roi. Ils se raccrochent à ce
fol espoir, trouvent une preuve évidente de leur conviction : le quartier de
l'église a été épargné.
Entre le 10 et le 15 juin, la
résistance locale et la préfecture parvinrent, en plusieurs tentatives, à entrer
en contact avec l'état-major allié et lui demandèrent d'épargner l'îlot
sanitaire Saint-Étienne. Des officiers supérieurs britanniques promirent de
faire leur possible, et la promesse fut globalement tenue.
LIRE ICI
« Que leur dire, si ce n'est que
j'y croyais aussi ? » avoue aujourd'hui l'abbé Lenormand. C'est un curé de choc,
qui officie à la dure. Parfois, les habitants matinaux le voient traverser
l'aube blafarde. Aumônier de prison, il assiste les condamnés à mort avant leur
exécution. A Saint-Etienne au moins, rien n'est perdu.
A
Malherbe, où les postes
sanitaires n° 1 et 2 ont finalement dû se replier et créer un hôpital
complémentaire, les blessés reposent sur les grandes tables de marbre du
réfectoire des lycéens. Au Bon-Sauveur, dans la salle de triage, c'est le
spectacle abominable des chairs éclatées, mutilées, déchiquetées. La première
semaine, le triage ne désemplit pas. On classe par ordre d'urgence, et on opère,
on coupe, on scie. Il faut sauver.
Et quand on ne sauve pas, il
faut enterrer. Les morgues de l'îlot sanitaire regorgent de cadavres : on a trop
à faire avec les vivants pour se préoccuper des morts. Il y en a partout, dans
les casiers, sur le pavé, alignés tels qu'ils sont arrivés, qui baignent dans
leur sang, avec attaché à leur cou, un numéro d'ordre. Mais au bout de deux ou
trois jours, l'odeur n'est plus tenable. Il n'y a plus de
cercueils - la « réserve » de cinq cents
cercueils des pompes funèbres est partie en fumée - et les cimetières sont
inaccessibles. On enveloppe les corps dans des housses de papier huilé - mais
bientôt, ils n'auront plus rien que leurs vêtements -, on relève quand c'est
possible l'identité des défunts et on les dépose dans de grandes fosses
communes.
« Ainsi, dit Bernard Goupil, j'eus à surveiller le transport
dans la Prairie des victimes des premiers bombardements, jusqu'alors placées
dans des classes du lycée, et qui se putréfiaient sérieusement. Tous ces
cadavres furent emmenés dans une grande fosse, creusée près des tribunes du
champ de courses. Il était important d'établir le plan et l'ordre dans lesquels
avait lieu cet enfouissement pour permettre aux familles de faire exhumer les
leurs ultérieurement. »
On enterre ensuite dans le jardin du lycée Malherbe. A la
va-vite, entre deux alertes.
LIRE ICI
« Un jour, se souvient l'abbé Lenormand, le sacristain
m'annonce : inhumation à 15 heures. A l'heure dite, je me rends à la morgue, le
corps était déjà parti. Je me rends dans le jardin, j'aperçois un rassemblement
de personnes, je m'approche, et j'entends quelqu'un parler du Seigneur à voix
haute. Quelqu'un avait pris ma place ! Je m'approche encore et je me rends
compte qu'il s'agissait des obsèques d'un protestant. Je me suis contenté de
présenter mes condoléances à la famille. »
Etonnante tour de Babel. Hantée par la mort, peuplée de
souffrances, couverte de meurtrissures, elle grouille pourtant d'une vie
intense, d'une vie en urgence. La nuit, dans l'église refuge, des couples font
l'amour, trop peu sûrs d'avoir un lendemain.
Au sein d'une population hagarde, une poignée d'hommes et de femmes, quelques
centaines, refusent de se laisser aller, de se laisser glisser. Resté en place
après les inévitables « désertions », ce noyau dur d'irréductibles qui risquent
leur peau pour sauver celle des autres, est éclaté, disséminé dans tous les
secteurs indispensables à la subsistance de la cité martyrisée. On les trouve
partout : à la Défense passive, à la
Croix-Rouge, au
Secours national, parmi les
médecins, les sapeurs-pompiers, les infirmières,
les
ambulancières bien sûr.
Mais également dans les services municipaux, ceux de la
préfecture, dans l'église, à
la police, aux Ponts et Chaussées ou encore
au
service du ravitaillement. Il faut héberger, nourrir, soigner quotidiennement
des milliers de personnes. Il faut accoucher les femmes enceintes, trouver du
lait pour les nourrissons, du carburant ou du combustible pour les véhicules,
trouver du sang pour les transfusions également, alors qu'il en coule tant et
tant. Il faut tenir la baraque, juguler le désordre, improviser, organiser,
rendre possible l'impossible. Il faut sévir aussi, faire la police. Contre les
tricheurs, les truqueurs, les voleurs : requis pour effectuer des corvées, des
hommes valides refusent de bouger. Ils sont privés de repas. Du chirurgien au
cuistot, de la religieuse au brancardier, de la blanchisseuse au mécano, c'est
la course au miracle, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans le moindre
répit.
Opération-survie : le danger balaie les hiérarchies,
bouleverse les valeurs, terrasse les préjugés. Soudainement peu recherchés, le
pouvoir et l'autorité trouvent leurs vrais serviteurs, ceux qui n'ont pas
déserté. De nouvelles et lourdes responsabilités se concentrent sur quelques
caractères bien trempés. Sans considération d'âge ni d'ancienneté. Exemple :
Dès le 6 juin, Gilles Rivière devient le patron des
Equipes
d'urgence.
Membre de la Résistance, le
chef des Equipes d'Urgence de Caen, Adeline, était en mission dans l'Orne le 6
juin. (Note de MLQ: le docteur Adeline chirurgien-dentiste n'est pas cité
dans ce CD
 comme membre de la Résistance !) Gilles Rivière, responsable de l'équipe des étudiants des facultés, prit
alors sa place, secondé par
René Streiff qui dirigeait jusqu'alors « les lycéens
Malherbe ».
comme membre de la Résistance !) Gilles Rivière, responsable de l'équipe des étudiants des facultés, prit
alors sa place, secondé par
René Streiff qui dirigeait jusqu'alors « les lycéens
Malherbe ».
Rien, absolument rien ne l'a préparé à affronter l'ouragan de
feu qui s'abat sur Caen. Seule sa participation et celle de ses coéquipiers au
sauvetage des victimes de la terrible « semaine rouge » de Sotteville-lès-Rouen
quelque temps auparavant' lui ont donné sans qu'il le sache un avant-goût de ce
qui l'attend maintenant.
Afin de désorganiser le
réseau ferroviaire, l'aviation alliée bombarda l'importante gare de triage de
Sotteville-lès-Rouen à plusieurs reprises en mai 1944. Les dégâts furent
considérables et il y eut de nombreuses victimes.
Le 19 avril
1944 de 00H13 à 00H58, un
bombardement de Rouen par les
Alliés atteint de nombreux monuments
emblématiques de la ville, faisant près de 900 victimes sur Rouen et son
agglomération. Près de 6 000 bombes sont larguées sur l'agglomération, plus de 3
000 impacts dans la commune de Sotteville-lès-Rouen, plus de 500 à
Saint-Etienne-du Rouvray et près de 300 au cœur de Rouen.
Consulter ce
site )
Mais pour le reste... « Nous autres étudiants étions
évidemment plus habitués à manier bouquins et cahiers que pelles et pioches. »
Étudiants et autres, car les membres des Equipes d'Urgence
proviennent de tous les milieux. Ils sont jeunes, incroyablement jeunes, se
battent sur tous les fronts, affrontent tous les coups durs. Formidablement unis
et solidaires, audacieux et débrouil
lards,
ils font preuve d'un enthousiasme, d'une insouciance qui contrastent avec le
désespoir ambiant. Physiquement plongés dans un bouillonnement d'atrocités, ils
noient spleen, écœurements et répulsions sous un déluge de blagues et de fous
rires. Le présent est à la barbarie, mais l'avenir leur appartient. Même si,
pour certains d'entre eux - Pierre Favier
 , quinze ans, mortellement blessé par
un éclat de vitre et Bernard Auvray
, quinze ans, mortellement blessé par
un éclat de vitre et Bernard Auvray , brûlé vif en luttant contre l'incendie -,
le terminus survient très tôt, ils mordent dans la vie avec une ardeur et une
insolence qui laissent peu de prise au malheur.
, brûlé vif en luttant contre l'incendie -,
le terminus survient très tôt, ils mordent dans la vie avec une ardeur et une
insolence qui laissent peu de prise au malheur.
« Un jour, raconte Gilles
Rivière, un copain retrouve deux bouteilles de butane intactes dans sa maison
détruite. Pour nous, c'était Noël : on allait pouvoir faire chauffer notre
tambouille au PC du lycée. Mais comme on craignait de se faire confisquer notre
trésor par un service officiel quelconque, on a eu l'idée de mettre les deux
bouteilles sur un brancard et de les recouvrir d'un drap. On a fait le chemin à
pied, devant des gens qui, sur notre passage, se découvraient et se signaient. »
Infatigables, ils partent en
commando sur les lieux bombardés, et avec leurs pauvres outils de terrassiers
s'attaquent à des montagnes de gravats. Bien entendu, ils éprouvent un sentiment
d'impuissance devant l'énormité de la tâche à accomplir. Remuer des tonnes de
pierre, de béton et de ferraille avec une simple pelle, cela vous rend tout
petit. Mais ils ne se découragent pas : il y a les vies à sauver, les emmurés à
dégager.
Il n'y a pas seulement le
travail de déblaiement. Il faut brancarder les blessés sur des centaines de
mètres et le plus souvent sur des civières de fortune jusqu'aux ambulances
bloquées par les décombres. Lutter contre l'incendie qui continue de dévorer le
cœur de la cité. Là encore, avec des moyens dérisoires.
C'en est presque risible. Tout
le matériel des sapeurs-pompiers a été détruit par le bombardement. Ozounian, un
étudiant de l'Institut de Chimie, parvient tout de même à bricoler deux
motopompes et à les remettre en activité, mais les lances sont trouées de
partout. Elles fuient tant et tant qu'il ne reste plus à l'extrémité qu'un
ridicule jet d'eau.
Grâce au courage et à l'intelligence d'un
ingénieur du service des Mines dénommé Fredy, le feu sera vaincu au bout d'une
douzaine de jours : accompagné des membres des Equipes
d'Urgence, de volontaires de la police ou
de sapeurs-pompiers, Fredy s'approvisionne à plusieurs reprises en explosifs au
dépôt voisin de
Saint-Martin-de-Fontenay. C'est un « salaire de la peur » avant
l'heure, car la route est constamment mitraillée et une seule balle dans la
cargaison suffirait à tout faire sauter. Mais les convois passent. Fredy utilise
en tout douze cents kilos d'explosifs qu'il dispose, seul, au plus près des
flammes. Il fait sauter ainsi un par un les immeubles menacés par les flammes,
fait le vide, affame le sinistre.

Pendant les heures de « répit », les équipiers d'urgence
participent à l'accueil des réfugiés, récupèrent vêtements et tous objets
utiles, se mêlent aux périlleuses expéditions pour le ravitaillement.
Dès les premiers jours de « la bataille de Caen », trouver de
la nourriture devient une obsession et un sport dangereux. Pratiqué au
quotidien. Chaque jour, des milliers et des milliers de repas sont servis dans
les centres d'accueil : mille cinq cents à
l'hospice Saint-Louis, quatre mille
au Bon-Sauveur, mille cinq cents au lycée Malherbe.
C'est, cinquante ans après, le « calvaire » avoué de Chantal
Rivière, à l'époque Chantal Nobécourt, responsable des équipes féminines
d'urgence :
« A Malherbe, les gens étaient nourris en trois services
successifs. A chaque fois, cinq cents personnes utilisaient les mêmes assiettes
et les mêmes couverts. Sans les laver bien entendu. Pour moi, c'était le comble
de l'horreur. »
Mais les assiettes sont garnies. Et le resteront jusqu'au
dernier jour. Massacré par la guerre tout comme les humains, le bétail fournit
de la viande en abondance. On installe même un parc dans les dépendances du
Bon-Sauveur pour les animaux que l'on rapatrie des herbages. Ramassés par
camions dans la campagne environnante, les produits laitiers ne manquent pas non
plus. Les équipes d'urgence ont des vaches qui paissent dans la Prairie et
qu'ils vont traire matin et soir pour approvisionner la biberonnerie du lycée.
Il y a du vin et du cidre. Pour l'eau, par contre, il faut se débrouiller.
Toutes les canalisations ont été détruites par les bombardements, des puits sont
rouverts, remis en activité. C'est le temps des corvées de seaux.
« Franchement, ironise Gilles Rivière, on mangeait plutôt mieux qu'avant le
débarquement. Car les vivres étaient bloqués,
ne disposaient plus de débouchés vers
l'extérieur. On récupérait des tas de provisions, on raflait les réserves des
épiceries en gros. Une fois, je me souviens avoir ramené avec un camion sept à
huit tonnes de
Livarot : on en a mangé assez pour nous en dégoûter jusqu'à la
fin de nos jours. »
De tous les témoignages, de tous les récits parus sur « la
bataille de Caen », il ressort que le jeune chef - « D'abord, il n'y avait pas à
proprement parler de chef, proteste celui-ci. On était tous dans la même galère
et on avait autre chose à faire que de se soucier de l'organigramme du service.
En fait, c'était l'inorganisation la plus totale. » - se montre d'emblée à la
hauteur de la situation. On évoque son flegme, son sang-froid, son courage. On
se souvient de son hospitalisation. Terrassé par un phlegmon à la gorge, il est«
aux contagieux ». Survient
le bombardement du 7 juillet, le plus terrible qu'ait
connu la ville avec ceux du 6 juin. Gilles Rivière est debout, travaille toute
la nuit à la tête de ses équipes : « Je n'avais plus rien, affirme-t-il, j'étais
subitement guéri. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas par quel miracle. »
Et il réfute en bloc tous les superlatifs pour ne revendiquer
qu'une seule « qualité » :
« J'étais totalement inconscient. Et bien d'autres avec moi.
Je n'ai pas peur de dire que ces journées terribles ont été les plus exaltantes
de mon existence : j'avais vingt ans et la conviction de servir à quelque chose.
De plus, j'avais une liberté d'action ahurissante. Nous étions totalement
décrochés des servitudes quotidiennes. Je n'ai pas le souvenir, par exemple,
durant ces deux ou trois premiers jours d'avoir réellement mangé, de m'être mis
à table. On buvait un coup, on grignotait un morceau et on repartait. Enfin,
j'avais la chance de ne pas avoir peur. Car l'héroïsme, le vrai, c'est de
trembler et d'y aller quand même. J'avais un copain étudiant, Desprairies, qui
était dans ce cas, qui crevait de trouille, et qui était volontaire pour les
missions les plus dangereuses. Comme aller à Fleury sous les bombes, porter des
médicaments aux réfugiés des grottes. Ça, c'est de l'héroïsme.
« Nos contacts avec la population étaient curieusement réduits au strict
minimum, concède également Gilles Rivière. Manque de temps, toujours. Mais
également le sentiment non avoué de ne pas vivre les mêmes événements ou tout au
moins de ne pas les subir
comme la plupart des gens les subissaient
pour diverses raisons humaines ou familiales. Ainsi, je me souviens que le 7
juin au matin, nous sommes allés visiter les abris qui existaient le long du
canal et du bassin dans le quartier Saint-Jean. Nous avons appelé : pas de
réponse. Craignant le pire, nous sommes descendus. Tout le monde était là, figé
par la peur, refusant de sortir. Sur le coup, j'avoue avoir eu du mal à
comprendre. »
Secouristes en surface, secourus en sous-sol. Dès le premier
bombardement du 6 juin, Chantal Nobécourt choisit elle aussi : « L'atmosphère
avait été si angoissante, si oppressante dans l'abri que j'en suis sortie en me
promettant que plus jamais je n'y retournerai. A partir de ce jour, j'ai préféré
voir tomber les bombes. »
Elles vont tomber durant des semaines. Continuellement
débordés, submergés par l'ampleur de la lutte à mener, les sauveteurs ne se
préoccupent guère du sort de la bataille qui se joue aux portes de la ville. Ils
captent les rumeurs de la foule ou bien écoutent parfois les bribes
d'informations à la radio. Mais ce qui leur importe, c'est de savoir si les
équipiers partis il y a quatre heures sont bien rentrés, si la voiture à bras
espérée a pu être récupérée, si les occupants de l'immeuble ont bien été sauvés.
« Nous formions une sorte de clan, admet Chantal Rivière,
grisé, dopé par les difficultés quasi insurmontables que nous devions affronter.
Nous vivions dans un cercle très fermé. Ce chaos était presque notre chaos
personnel et on ignorait complètement ce qui se passait à l'autre bout de la
ville. »
Aux frontières de Caen. Là où les Anglais piétinent.
D'un seul élan ou presque, les Alliés s'étaient pourtant engouffrés sur les
routes de la mer, avaient submergé
Courseulles.
Ouistreham ou
Bernières. A
l'aube du 6 juin, avant que ne commence leur calvaire, les habitants de la
grande ville avaient plaint les plages de leurs vacances.
Source: chapitre II, pages 191 à 208 de ce
livre.
ajouts MLQ
RETOUR LISTE DES TEMOIGNAGES
 , commandant en chef des armées
terrestres, avait annoncé : « Si l'ennemi nous devance à Caen et que ses
défenses se révèlent trop solides pour que nous puissions capturer cette ville
le jour J, Caen sera pilonnée par nos bombardiers afin d'en restreindre
l'utilité par l'ennemi. »
, commandant en chef des armées
terrestres, avait annoncé : « Si l'ennemi nous devance à Caen et que ses
défenses se révèlent trop solides pour que nous puissions capturer cette ville
le jour J, Caen sera pilonnée par nos bombardiers afin d'en restreindre
l'utilité par l'ennemi. » prend la cité normande pour
cible. Le cauchemar des Caennais qui, par milliers, survivent ou meurent dans la
fournaise, durera jusqu'au 19 juillet.
prend la cité normande pour
cible. Le cauchemar des Caennais qui, par milliers, survivent ou meurent dans la
fournaise, durera jusqu'au 19 juillet.


 ) discute avec son frère Jacques. Parvenue sur la place
Saint-Martin, elle remarque le ciel changeant, rougeoyant.
) discute avec son frère Jacques. Parvenue sur la place
Saint-Martin, elle remarque le ciel changeant, rougeoyant.

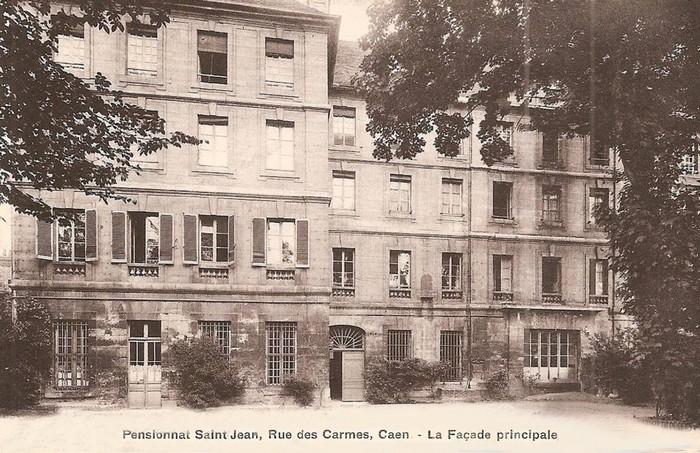




 (témoignage recueilli en 1984) , résistant du
(témoignage recueilli en 1984) , résistant du
 le 22 mai 1944)
, un gamin de quinze ans, se retrouve dans la même position. Pendant ce
temps-là, leurs compagnons franchissent la porte qui ouvre sur les courettes. En
tournant légèrement la tête sur le côté, Barjaud les aperçoit. C'est à chaque
fois le même sinistre cérémonial : un groupe, la porte qui se ferme, une
mitraillette qui tire au coup par coup. Une balle dans la nuque. Et parfois, un
coup de grâce. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite.
le 22 mai 1944)
, un gamin de quinze ans, se retrouve dans la même position. Pendant ce
temps-là, leurs compagnons franchissent la porte qui ouvre sur les courettes. En
tournant légèrement la tête sur le côté, Barjaud les aperçoit. C'est à chaque
fois le même sinistre cérémonial : un groupe, la porte qui se ferme, une
mitraillette qui tire au coup par coup. Une balle dans la nuque. Et parfois, un
coup de grâce. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite.
 (témoignage recueilli en 1984) - également
membre du réseau Arc-en-Ciel, arrêté le 28 mai 1944 - voit la porte de sa
cellule s'ouvrir brusquement : « Jouvin, Loslier... Raus ! »
(témoignage recueilli en 1984) - également
membre du réseau Arc-en-Ciel, arrêté le 28 mai 1944 - voit la porte de sa
cellule s'ouvrir brusquement : « Jouvin, Loslier... Raus ! »
 , baignant dans son
sang.
, baignant dans son
sang.

 , abattu l'après-midi, et qui horriblement
torturé quelques jours plus tôt, avait confié à André Lebrun : « T'en fais pas,
on est dans le bon, c'est pour bientôt. » Il y a le comte Guy de Saint-Pol
, abattu l'après-midi, et qui horriblement
torturé quelques jours plus tôt, avait confié à André Lebrun : « T'en fais pas,
on est dans le bon, c'est pour bientôt. » Il y a le comte Guy de Saint-Pol
 ,
originaire d'
,
originaire d' .
Né le 21 septembre 1915 à
.
Né le 21 septembre 1915 à


 , quinze ans, mortellement blessé par
un éclat de vitre et Bernard Auvray
, quinze ans, mortellement blessé par
un éclat de vitre et Bernard Auvray , brûlé vif en luttant contre l'incendie -,
le terminus survient très tôt, ils mordent dans la vie avec une ardeur et une
insolence qui laissent peu de prise au malheur.
, brûlé vif en luttant contre l'incendie -,
le terminus survient très tôt, ils mordent dans la vie avec une ardeur et une
insolence qui laissent peu de prise au malheur.
